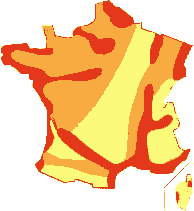|
Croissance démographique : les campagnes ne fournissent
plus assez de travail pour occuper l'excédent de population.
Révolution industrielle :
découvertes techniques permettant la mécanisation de
la production.
Passage du stade artisanal à la fabrication de produits grâce aux machines.
Fin de l'ouvrier paysan.
Concentration des machines
dans des usines implantées en villes.
Importants besoins en main
d'œuvre dans les usines naissantes = exode
rural massif.
Þ Amorce de la croissance urbaine.
Entassement des néo-citadins
dans des "tenements".
Début de la taudification
des centre-villes.
Mais la majorité
de la population française vit encore dans les campagnes.
|
Renforcement du processus d'urbanisation.
Poursuite de l'exode
rural.
Années 1920 :
la France devient un Etat à dominante urbaine (plus de 50 % de la population réside désormais en ville).
Lent déclin du monde rural.
Les jeunes partent travailler
en ville. Seuls les anciens restent : vieillissement de la population
rurale (fermeture des écoles).
Dépeuplement des
villages et mort programmée pour certains (fermeture des commerces ruraux
-tabac-épicerie- par manque de clients).
Corollaire : explosion urbaine.
Poursuite de la dégradation
des quartiers centraux.
Les nantis s'installent dans
des quartiers qu'ils se réservent ou en périphérie de la ville.
L'espace urbain devient tentaculaire.
|
Après la Seconde Guerre mondiale,
l'Etat prend en charge une partie de l'accueil des nouveaux arrivants.
De grands programmes d'Habitations
à Loyer Modéré sont lancés.
L'aspect des villes change :
elles deviennent des villes de plus en plus hautes.
Il faut entasser un maximum
de gens sur un espace urbain, donc de plus en plus rare.
C'est l'apogée de l'urbanisation en barres (le Haut du
Lièvre à Nancy, les Minguettes à Vénissieux...
A la fin des années
1960, l'exode rural s'est tari.
Les villes ont atteint leur
capacité maximale.
Naissance d'un
phénomène : la rurbanisation.
Lassés du bruit, de la pollution,
du manque d'espace des villes, de jeunes couples avec enfants fuient la
ville et redécouvrent la sérénité de la campagne.
Ils lotissent à un 30aine
de km de leur ancien lieu de résidence.
Ils continuent cependant à
travailler dans la ville qu'ils viennent de quitter.
Ces rurbains accomplissent chaque jour des mouvements pendulaires depuis leur domicile
jusqu'à leur lieu de travail.
Assiste-t-on à
un exode urbain ?
Les campagnes françaises se
repeuplent-elles ?
Celles proches des villes accroissent leurs effectifs grâce à
la rurbanisation, alors que celles du «rural profond» (trop loin des grandes
agglomération : centre du Massif Central), dépeuplées par l’exode passé,
ne connaissent pas de véritable reprise.
|